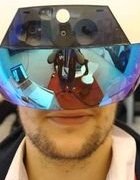Corgarashu - stock.adobe.com
Oracle vs Google : suite et fin de la saga judiciaire américaine sur la protection des API
Après 10 ans de bataille judiciaire opposant Oracle et Google, la Cour Suprême américaine a tranché. Selon elle, le second n’a pas commis de faute en reproduisant dans Android 11 500 lignes de code de l’API de Java.
Après 10 ans de bataille judiciaire opposant Oracle America Inc et Google LLC, la Cour Suprême américaine a tranché en faveur de Google et considéré que cette dernière n’avait pas commis de faute en reproduisant dans Android 11 500 lignes de code de l’API de Java (décision du 5 avril 2021, n° 18-956).
Petit rappel pour ceux qui ont raté le début : en 2005, Google acquiert la start-up Android Inc, avec pour ambition de développer un système d’exploitation pour terminaux mobiles, lequel serait gratuit et totalement ouvert. Compte tenu de la popularité du langage Java et de la plateforme Java SE auprès des développeurs, Google décida de copier près de 11 500 lignes de code de l’API Java, dont les droits sont désormais détenus par Oracle. Une bataille judiciaire à forts rebondissements s’ensuivit devant les tribunaux américains, jusqu’à ce que la Cour Suprême américaine vienne statuer sur les deux questions qui lui étaient posées, à savoir en substance :
- Les APIs, ou interfaces de programmation, sont-elles protégées par le droit du copyright (ou droit d’auteur, dans notre conception française ou européenne) ?
- La copie des 11 500 lignes de code de l’API Java relevait-elle du « fair use » (que nous traduirons par « usage équitable »), concept de droit américain permettant d’échapper, dans certains cas, au copyright ?
Alors même que la décision de la Cour Suprême a été largement disséquée par nombre de commentateurs ayant crié victoire pour le secteur du logiciel libre, le diable se cache souvent dans les détails et la décision de la Cour Suprême n’en manque pas.
Premier détail, et non des moindres : en dépit des titres d’articles racoleurs utilisés par certains commentateurs, la Cour Suprême ne s’est finalement pas prononcée sur la question de la protection des API par le copyright, du moins pas expressément. Elle aurait pourtant dû, mais par une splendide pirouette, la Cour a préféré se contenter de répondre à la seconde question : la copie des 11 500 lignes de code relevait-elle du fair use ?
Pour vos serviteurs, il est évident qu’en éludant la question de la protection par le copyright des API pour se concentrer sur la question du fair use, la Cour Suprême a tacitement considéré que les API sont susceptibles d’être protégées par le droit du copyright. En effet, le fair use américain constitue une exception au copyright, tout comme il existe en France des exceptions au droit d’auteur (cf. article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle). Or, se poser la question de l’applicabilité d’une exception implique qu’en amont, le droit auquel il serait fait exception existe. La Cour Suprême n’a donc pas dit que les API ne peuvent être protégées par copyright. Au contraire, elle semble implicitement partir du postulat qu’elles le sont.
Reste qu’après avoir rappelé les facteurs à prendre en considération pour savoir si l’utilisation d’une œuvre protégée par copyright peut relever du fair use (de sorte que l’autorisation du titulaire du copyright n’est pas requise), la Cour Suprême a considéré qu’en l’espèce, la copie des 11 500 lignes de code de Java relevait du fair use.
Premier facteur étudié par la Cour : la nature de l’œuvre copiée. Au cas particulier, la Cour Suprême a considéré que la copie portait seulement sur des « declaring codes », fonctionnels par nature (comme tout programme informatique), mais intimement liés à des idées non protégeables, et que ces parties de code ne tirent leur valeur que de l’utilisation qui en est faite par les programmeurs, consistant à appeler des fonctions (qui, elles, n’ont pas été copiées).
Le deuxième facteur porte sur l’objectif et le caractère de la copie. Il s’agissait alors d’identifier dans quelle mesure l’utilisation du code copié s’inscrivait dans une démarche de création, de nature à apporter quelque chose de « nouveau et important ». Sur ce point, la Cour Suprême a considéré que l’ambition de Google était de créer un produit nouveau, et que sa démarche relevait du « progrès créatif », véritable pilier constitutionnel du copyright américain.
Pour le troisième facteur, la Cour s’est intéressée à la quantité et au caractère substantiel du code copié au regard du code original dans son intégralité. La Cour a alors retenu que les 11 500 lignes de code copié ne représentent que 0,4 % du code global de l’API Java, laquelle est constituée de 2,86 millions de lignes de code.
Enfin, le dernier facteur concerne l’effet de cette copie sur le marché. La Cour a alors considéré que la solution Android pour les mobiles n’a pas vocation à remplacer la solution JAVA SE sur son propre marché. Il est même retenu qu’elle bénéficie également aux utilisateurs de JAVA SE. À l’inverse, le fait de considérer que le droit d’auteur autoriserait Oracle à bloquer toute utilisation des codes de son API sans son accord porterait un lourd préjudice à la création informatique.
Pour toutes ces raisons, la Cour Suprême a conclu que « la copie de l’API par Google pour réimplanter une interface utilisateur, en ne prenant que ce qui était nécessaire pour permettre aux utilisateurs de mettre leurs talents accumulés au service d’un programme nouveau et transformateur, constituait un usage loyal de ce matériel en droit ». Partant, la Cour a retenu que Google pouvait valablement se prévaloir du fair use, de sorte que la copie de 11 500 lignes de codes de l’API Java ne violait pas le copyright d’Oracle.
Pour autant, il ne faut pas faire dire à la Cour Suprême ce qu’elle n’a pas dit – ce dont certains commentateurs ne se sont pas privés – et rien dans sa décision ne laisse entendre que les API ne sont pas protégeables ou protégées par le droit du copyright. Tout au plus faut-il retenir que ce copyright n’est pas absolu et peut souffrir des exceptions résultant d’applications plus ou moins rigoureuses de la doctrine du fair use. À cet égard, il est notable que la décision de la Cour Suprême n’a pas été prise à l’unanimité de ses membres, et la position écrite prise par l’un d’eux – le juge Clarence Thomas – montre que la décision de la Cour Suprême n’est pas d’une rigueur juridique absolue.
Il n’en demeure pas moins qu’elle s’inscrit dans une intention tout à fait louable de préserver autant que possible un équilibre entre d’une part, le monopole que le copyright confère à son bénéficiaire et d’autre part, l’intérêt du public.
En conclusion, quelles conséquences tirer de cette décision américaine pour les développeurs européens ? Commençons par rappeler qu’en Europe, la directive 2009/24/CE prévoit expressément que les idées et principes qui sont à la base d’un programme d’ordinateur, en ce compris ses interfaces, ne sont pas protégées par le droit d’auteur. Tout laisse donc à penser que les interfaces de programmation, dont relèvent les API, sont exclues de protection par le droit d’auteur. Le droit d’auteur, dans sa conception européenne, ne fait a priori donc pas obstacle à la copie du code d’une API.
A priori seulement, car il ne faut pas oublier que le droit d’auteur n’est pas seul en son royaume et qu’il existe d’autres moyens juridiques de faire sanctionner la copie un peu trop servile, par exemple en fondant son action non pas sur le droit d’auteur, mais sur la concurrence déloyale ou le parasitisme.
Le programmeur européen pourrait-il être inquiété sur le sol américain, si son programme copie des lignes de code issues d’une API développée aux États-Unis ? La décision de la Cour Suprême ouvre une brèche dans laquelle il serait tentant de s’engouffrer, mais la tentation ne doit pas occulter la raison : le fair use dont a pu bénéficier Google pour le projet titanesque qu’était alors le développement d’Android, n’est peut-être pas à la portée de tous.
Pour approfondir sur Réglementations et Souveraineté
-
![]()
WeTransfer se donne les pleins pouvoirs sur vos contenus : comment vous protéger ?
-
![]()
IA et droits d’auteur : victoires fragiles pour Meta et Anthropic dans la guerre du « fair use »
-
![]()
« Fair use » : Anthropic échappe à une injonction des majors musicales
-
![]()
Les plans « no limit » des Américains pour dominer le monde de l’IA