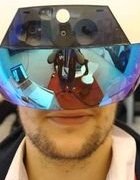olly - stock.adobe.com
Les nouveaux métiers de la tech, ou le mirage du « bonheur » en entreprise
Depuis qu’on parle « licornes », « start-up nation », il est de bon ton aussi de créer de « nouveaux » métiers, censés apporter aux salariés des conditions idéales, voire le « bonheur » au travail. Mais quand la réalité rattrape le « bonheur », l’atterrissage peut être rude.
C’est devenu une mode, transmise en droite ligne les start up de la Silicon Valley, fondée par des surfeurs de la côte ouest forcément cools et sympas avec leurs salariés. Dans les entreprises de la tech, place à la « bienveillance » au travail – avec baby-foot, fat boys, cafétéria sympa et produits bio à gogo – et aux métiers qui accompagnent cette tendance au départ très « disruptive ».
L’auteur de BD Fix a pointé avec beaucoup d’ironie cette tendance dans une BD au nom évocateur « Chief Bullshit Officer », parue aux Éditions Diateino fin mars 2022. « Fix », ou François-Xavier Chenevat, possède un lourd passé de consultant pendant 12 ans dans un cabinet de conseil parisien. On lui doit les savoureux « Réussir son burn-out », « Innover sans se fatiguer », ou encore « IT Blues ».
Pour « Chief Bullshit Officer », le script de l’éditeur vaut à lui seul le détour : « Léonce est cadre en entreprise. Chaque jour, il vit de merveilleuses aventures au bureau, entre délires mégalos du boss, visioconférences qui tournent mal et excès de jargon californien. Il y aurait même croisé une intelligence artificielle pas très maligne. Dans la lignée des héros du bureau comme Gaston Lagaffe ou Dilbert, on y croise Fred le DRH, Sandy la geek ou encore Jean-Kevin, le fameux “Chief Bullshit Officer” ». Âmes sensibles s’abstenir. Pour autant, la distance avec le réel n’est peut-être pas si grande que l’on pourrait le penser.
Lors d’un reportage dans une entreprise tech, j’ai rencontré une jeune « Chief Happyness Officer », une première pour moi. Confessant ma naïveté, je satisfais ma curiosité professionnelle et échange longuement avec elle et le PDG, tout heureux de ce poste dont il fait le panégyrique. « Happyness » peut se traduire par « bonheur », la (ou le !) « Chief Happyness Officer » est donc la personne responsable du bonheur, ou à tout le moins du « bien-être » des salariés dans l’entreprise. Tâche noble et écrasante.
Son rôle est d’organiser des « after », des rencontres régulières et amicales entre salariés, et d’aplanir les petites difficultés personnelles quotidiennes en fournissant un cadre de travail quasi idéal. Cela va du choix de la mutuelle à une éventuelle crèche pour les jeunes mamans, de l’ambiance du lieu de travail (plantes vertes, cafétéria, etc.). Le jour de ma venue, peu avant Noël, les bambins des salariés, en pleine préparation de l’arbre de Noël de l’entreprise, couraient un peu partout. Le PDG, ravi, distribuait des bonbons en pleine interview. Certes sympathique, quoique peut-être un peu puéril… et pas facile à gérer.
Autre exemple : le Prince Harry. Soucieux de refaire sa vie avec sa famille aux USA, loin des joyaux de la couronne d’Angleterre, il a été nommé « Chief Impact Officer » pour la start up californienne « Better Up » en mars 2021. Essayons de traduire, y compris le concept. « Responsable de l’impact », selon Madame Figaro du 7 février 2022, source de cette information, il faut comprendre « cadre chargé des questions de santé mentale, de durabilité et de l’impact d’une entreprise dans la société ». Fermez le ban.
L’« expérience » et la « bienveillance », nouveaux totems de la vie en entreprise ?
Jonathan Gotti, manager rencontré lors d’une interview chez Oodrive il y a quelques années, fin observateur de ces tendances, et interviewé au printemps, sourit : « j’ai vu passer pas mal de ces fonctions. Je connais par exemple un “Workplace and Experience Manager” dans une boîte tech ».
Dans le cas d’un poste comme celui-là, explique-t-il, la mission consiste en la possibilité de « faire en sorte que le cadre de travail, souvent en open space, soit le plus agréable et convivial possible. Mais, et c’est la partie à laquelle on ne pense pas, il faut régler tous les menus tracas du quotidien en entreprise : un robinet qui fuit, une machine à café en panne, un ascenseur en rideau »… Selon les postes, on passe d’architecte et décorateur d’intérieur à plombier en chef ou magasinier et responsable des approvisionnements, réparateur d’imprimante, voire on alterne dans la même journée.
Jonathan Gotti analyse avec beaucoup de pragmatisme et de recul ce phénomène : « au départ, il y a souvent une réelle bonne volonté de l’entreprise pour faire en sorte que les gens se sentent bien. Il faut créer de la confiance. Pourquoi ? Parce que ces entreprises tech sont jeunes, et que les cadres dirigeants ont cette mentalité. Par ailleurs, parce que la plupart des gens recrutés sont jeunes aussi, souvent coupés de leur famille et qu’il faut d’une manière ou d’une autre construire un environnement stable, chaleureux, où ils puissent se créer de nouveaux repères ».
Une famille bis ? J’ai toujours été frappée, dans ces entreprises, de voir à quel point le management laissait faire, voire favorisait la notion d’appartenance à une tribu et une famille, notamment dans le nom sous lequel les salariés se nomment – souvent baptisés en nom propre de l’entreprise, comme une tribu, comme les « Linuxiens » des grandes heures de l’opposition entre Microsoft et le logiciel libre. Des groupes, des ethnies, des tribus. Une famille.
Le bonheur pour apaiser les conflits en entreprise ?
Dominique Desjeux, anthropologue et Professeur émérite de Sociologie à Paris V, a notamment travaillé sur l’innovation, les processus de décision, et les organisations. Pour lui, « la création de ces fonctions liées au bien-être dans l’entreprise répond, de manière souvent imparfaite aux quatre grands clivages que connaît toute société et organisation. Ce sont les classes sociales (qui détient le capital ?), le genre, l’âge, et les différences culturelles (dans lesquelles on intègre la religion). À ces quatre clivages correspondent des rapports de force (patrons/salariés, hommes/femmes, vieux/jeunes, oppositions entre les religions et les valeurs familiales…) dans toute organisation, auxquels la création d’un poste comme le “CHO” essaie de répondre en supprimant, par la création d’un “bien-être” dans l’entreprise, ces sources de conflits ». C’est, selon lui, bien évidemment illusoire, mais ces métiers sont nés d’une volonté d’aplanir les tensions et les rapports de pouvoir, donc les conflits, inévitables dans toutes les organisations.
« C’est venu », explique Dominique Desjeux, « de tout un courant managérial et sociétal connu aux États-Unis sous le nom de “care” (littéralement, faire attention à, prendre soin de), qui a donné lieu en France à l’émergence du concept de RSE (responsabilité sociale des entreprises) ». Ce courant a fait son apparition au début de la décennie, probablement porté notamment par deux crises majeures outre-Atlantique – et au-delà – : les attentats du 11 septembre 2001, et la crise des subprimes.
« Quelque part entre morale, philosophie et projet politique, le concept peut paraître déroutant. D’abord, on ne le traduit pas en français, tant le terme anglais est efficace, mais, surtout, tant il est difficile à exprimer sans tomber dans une forme de sentimentalisme assez éloigné de notre rationalisme national. Dans le débat américain, il a d’ailleurs plusieurs acceptions : soin, souci, sollicitude, dévouement », note l’Express en 2013. Et nos confrères de résumer : « le “care”, ce serait avoir du cœur dans tous les champs de la société ».
Le « care » a été remis au goût du jour par la pandémie de Covid-19, avec ce fameux « prenez soin de vous », d’ailleurs généreux, par lequel nous avons tous un jour ou l’autre terminé un mail ou une conversation téléphonique depuis deux ans. « Vos propres voix en témoignent aussi, puisque l’expression “prenez-soin de vous” (“take care” en anglais) est aujourd’hui sur toutes les lèvres », rappelle France Culture.
La multiplication des crises crée naturellement chez tout être humain le besoin légitime d’une certaine gentillesse. Marre des brutes et d’un management « musclé » et intransigeant, place à la « bienveillance » et à l’empathie, à des décisions qui doivent être « justes ». Les managers sont attendus là-dessus et le savent. Plus personne ne se hasarderait aujourd’hui à employer, comme Jean Michel Apathie en 2010, le mot de « nunucherie ». On a tous besoin d’être un peu « nunuche », depuis quelque temps. Ou en tout cas, de faire attention les uns aux autres. Et le fameux adjectif « gentil » redevient une qualité, et n’est plus synonyme de « gourde », comme dans le film « le père Noël est une ordure », sorti en 1982.
Des « valeurs » en entreprise
La crise actuelle a sérieusement ébranlé le monde et les convictions des « Millenials », ces jeunes adultes nés à la fin du millénaire ou au début des années 2000. Ils auront successivement été marqués par (ou auront connu) le 11 septembre, les subprimes, les attentats terroristes, le réchauffement climatique, les gilets jaunes et deux ans de pandémie. « La loi de la jungle » ne sert plus à grand-chose dans le contexte actuel, et ils sont fort tentés d’y opposer un « pourquoi faire » ?
Il est évident qu’ils ne raisonnent pas comme leurs aînés au même âge, et que la réalisation de soi, et une certaine « bienveillance » leur est nécessaire. Ils les rechercheront en entreprise et avec la création de ces nouveaux métiers. Par contre, le but uniquement mercantile est de moins en moins affiché, et on parle de plus en plus de « valeurs ». Travailler aligné sur des valeurs, c’est ce que demandent les jeunes générations. D’où la nation d’appartenance à une tribu, déjà évoquée.
Ça part donc d’un bon sentiment. Sauf qu’il convient de rappeler une évidence de base : une entreprise a tout de même pour vocation première de gagner de l’argent, pour payer des salaires (contre un travail), grandir, générer de la croissance. Elle n’a pas, a priori, de vocation philanthropique, même si on sait que les entreprises qui ont des valeurs et une histoire fortes traversent les années et les crises plus facilement que les autres. Et que ces valeurs font souvent partie de la motivation d’un salarié, source de son implication dans son travail.
Saut que lorsque les entreprises ne sont pas cohérentes avec elles-mêmes, ou que ces fameuses valeurs se retrouvent confrontées à la dure réalité de la vie économique, ces fonctions miracles ont du plomb dans l’aile.
« On se heurte rapidement à la réalité du marché », relève Jonathan Gotti, « concernant la fonction de Chief Happyness Officer, les dirigeants (CEO) regardent ce que ça coûte… et ce que la leur rapporte ». Il est évident qu’en période de crise et à l’aune de plans sociaux ou d’un rachat, parler de bonheur dans l’entreprise… c’est compliqué.
« Ce sont les premiers postes qui sautent », analyse Jonathan Gotti. « Il faut être lucide », reprend-il : « quand un salarié choisit une entreprise, c’est un ensemble – le salaire, les avantages, le cadre de travail jouent dans sa décision. Mais l’élément décisif, c’est en premier lieu l’intérêt du poste et la façon dont il peut s’y épanouir. Et ce n’est jamais parce qu’il y a un Chief Happyness Officer que quelqu’un choisit un poste et une entreprise ».
Pour approfondir sur Recrutement
-
![]()
Pour son programme GenAI, Safran renouvelle son engagement avec AWS
-
![]()
En trois ans, la démocratisation des données est en nette progression (étude)
-
![]()
GenAI : stratégies pour tirer l’adoption auprès de vos collaborateurs
-
![]()
Démocratisation des données : un écart de perception flagrant entre directions et métiers (étude)