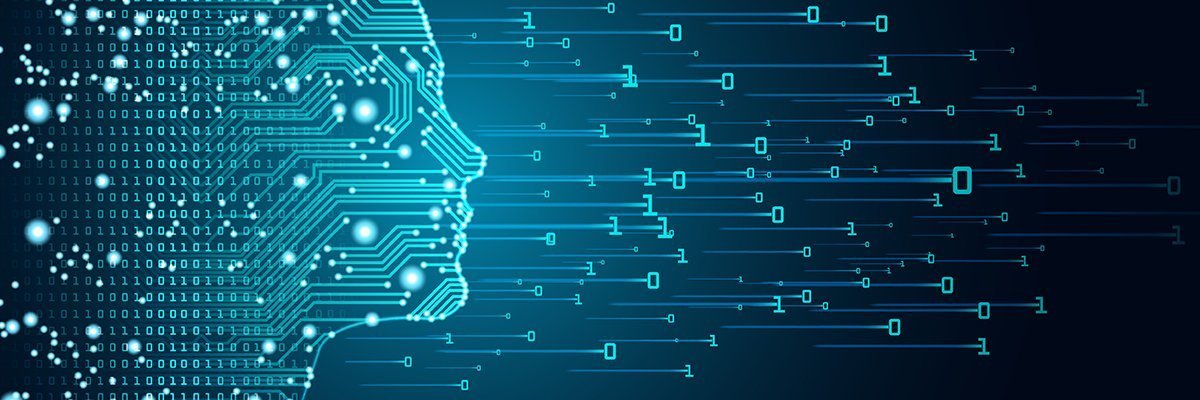Inde : manque de transparence sur les conditions de travail
Les salariés indiens des SSII sont-ils heureux ? Si l’on en croît leurs patrons, la réponse est clairement oui. Sous couvert d’anonymat, des salariés ont accepté de nous parler… pour exprimer tout le bonheur qu’ils rencontrent dans leur travail. Mais quelques voix s’élèvent pour rompre cette belle unanimité. Reste que la faiblesse de la représentation syndicale n’aide pas vraiment à clarifier le tableau.
Les difficultés que rencontrent les entreprises installées en Inde pour fidéliser leurs salariés pourraient laisser présumer de traitements de rêve pour ceux-ci. A écouter les dirigeants des SSII locales, on serait tenté de le croire avec, en tout premier lieu, un discours très positif sur les salaires. D’autant plus que, au sein de leurs impressionnants campus, les SSII indiennes ménagent de nombreux espaces de détente et autres avantages aux salariés. Chez KPIT Infosystems, à Pune, par exemple, on trouve une salle de musique complètement équipée pour le groupe de rock interne. Chez Sopra, à Noida, la direction a prévu une – petite – crèche. Et l’on peut ajouter à cela les terrains de tennis d’Infosys à Bangalore – déserts lors de notre visite – ou la salle de ping pong de KPIT Infosystems – à peine plus animée. Et même une cantine, ouverte 24h/24, où les salariés peuvent prendre déjeuner, dîner, petit-déjeuner, et snacks en pleine nuit.
Espace restauration, chez KPIT à Pune
Des salaires élevés pour le pays
Kishor Patil, directeur général de KPIT Infosystems, le rappelle : « sur les dix dernières années, les augmentations de salaires ont été très élevées, et très disproportionnées par rapport à l’inflation… et à d’autres industries. » Kris Gopalakrishnan, PDG d’Infosys, précise : au cours des dernières années, la progression annuelle des salaires a été de 13 à 15 %.
Les salaires indiens, vus par les patrons
De son côté, Harsh Inaniya, ancien salarié d’un spécialiste du BPO de la banlieue de New Delhi, va plus loin : son salaire initial était de l’ordre de 189 euros par mois, il y a trois ans. Très pragmatique, Harsh souligne que c’est ce bas salaire qui amène les entreprises à travailler avec des partenaires indiens. Dans le même temps, il relève l’absence de règle précise pour les heures supplémentaires, payées ou non, à la discrétion des entreprises.
Le regard d'un ancien salarié indien sur ses émoluments
Les salariés spécialisés dans le développement logiciel ou le services d’administration d’infrastructures sont généralement mieux rémunérés que dans l’externalisation de processus métiers. Après cinq ans d’ancienneté, l’un d’entre eux a évoqué avec nous un salaire de l’ordre de 1000 euros par mois ; un chiffre extrêmement élevé pour l’Inde. Mais qui mérite d’être relativisé : comme les dirigeants des SSII indiennes aiment à le rappeler, le salaire d’un employé profite généralement à quatre, cinq voire six personnes de son entourage proche.
Mais pour Partho Ganguli, ancien du cabinet IDC à New Delhi et désormais directeur exécutif de BOB Technologies, une SSII de Bangalore, les salaires versés par les SSII indiennes sont « confortables pour vivre à Delhi ; acceptables pour Mumbai, mais trop bas pour Bangalore ». Un simple voyage entre ces trois villes permet effectivement de mesurer certains - importants - écarts de prix entre elles.
Surtout, la crise est en train de passer par là. Ainsi qu’une inflation galopante – à plus de 10 % en octobre 2008, après être montée à plus de 12 % pendant l’été. Selon Kishor Patil, la faiblesse attendue des augmentations de salaires pour cette année ne sera, en définitive, qu’une forme de rattrapage. Pour Salil Parekh, PDG de Cap Gemini en Inde, cette augmentation ne devrait être que de l’ordre de 8 %. De son côté, le Nasscom, la chambre syndicale du patronat des SSII indiennes, prévient désormais : les hausses de salaire seront « modestes » au cours des 24 prochains mois du fait de la crise économique mondiale.
Des débutants corvéables à merci
Mais c’est probablement chez les plus jeunes que la situation est la plus préoccupante. Partho Ganguli explique ainsi que « plus les salariés sont jeunes, plus on leur en demande, jusqu’à 16h par jour. Chez Motorola, j’ai vu des gars bosser de 8h30 à 21h30. Ils pensent que l’argent compense tout, le stress, le temps, etc. Ces gens sont tellement conditionnés qu’ils pensent que c’est une vie normale. […] Je parle de conditionnement, parce que c’est en partie à cela que sert la formation [initiale, dispensée à l’entrée dans l’entreprise, NDLR]. »
Et c’est dans le domaine de l’externalisation des processus métiers que les ravages seraient les plus importants. Pour Partho Ganguli, « les gens bossent pour l’argent mais ramènent la culture US à la maison, en rentrant du call center. C’est une importante source de détresse ». Et d’y voir une explication à l’attrition élevée dans les entreprises BPO. Chez Logica, on reconnaît que « quand un salarié indien arrive au bureau, il devient européen. » Mais on assure que « quand il rentre chez lui, il redevient indien ». Harsh Inaniya, ancien salarié d’une entreprise spécialisée dans le BPO conteste cette affirmation, déplorant, en outre, les effets néfastes des horaires de travail.
Les effets pervers du BPO sur les salariés indiens
Dans un billet sur notre blog Indi@, Devidas Deshpande, journaliste au quotidien Pune Mirror, revenait, début août dernier, sur les conséquences de la difficile cohabitation entre les indiens habités par la culture occidentale et leurs contemporains plus traditionnalistes. L’auteur indien Lavanya Sankaran confirme ces propos.
Des styles de vie parfois source de conflits
Certes, les entreprises mettent en avant leurs propositions d’horaires flexibles. Mais pour Partho Ganguli, « ça existe plus sur le papier que dans la réalité. Sur les projets critiques, il faut de toute manière être là entre 11h et 13h. » Et il faut aussi compter sur les problèmes liés à l’énergie, qui « limitent le développement du télétravail. »
Pour ajouter à cela, il faut relever que la formation n’est généralement qu’en partie assurée sur le temps de travail hebdomadaire. Chez Wipro, par exemple, où l’on présente la formation comme la pierre angulaire de la performance de l’entreprise, environ la moitié du temps de formation est prise sur le temps libre. Un phénomène loin d’être isolé. Pour Karthik Shekkar, syndicaliste, « la plupart du temps, la formation a lieu sur le temps libre ; souvent, c’est même sur les week-ends. »
Des salariés heureux
Dans l’une des grandes cités indiennes de l’industrie IT, nous avons pu discuter avec deux employés d’une entreprise de développement logiciel. Il faut souligner que recueillir des témoignages n’est pas simple : la plupart des salariés profitent des bus déployés par leurs employeurs pour effectuer leurs déplacements domicile-travail ; sur les campus, accoster un salarié ne peut potentiellement que conduire à obtenir un écho du discours officiel, escorté que l’on est par un porte-parole de l’entreprise. Les témoignages de ces deux jeunes développeurs sont surprenants de candeur et d’enthousiasme. L’un d’entre eux, dont le salaire de chef d’équipe est de l’ordre de 1000 euros par mois, s’estime ainsi « trop payé » par rapport au reste de la population active indienne. Et tant pis si ses heures supplémentaires ne sont pas rémunérées.
Un salarié de SSII en Inde heureux
Tout aussi épanoui dans son environnement professionnel, le second, qui occupe un poste d’assistant de chef de projet, souligne que l’entreprise pour laquelle il travaille est « nouvelle », du moins ses installations en Inde n’ont-elles que deux ans d’existence. Du coup, « il n’y a pas de pression. […] La direction de la maison mère comprend que l’on est en phase de démarrage, d’apprentissage. » Mais il apprécie aussi certaines « facilités » comme la flexibilité du temps de travail. Son salaire ? Il n’a pas le droit d’en discuter, même avec ses collègues, « c’est contre les règles de la direction des ressources humaines ». Mais il nous l’apprend tout de même : de l’ordre de 800 euros par mois.
Bangalore, la capitale indienne du suicide
Mais le bonheur n’est pas toujours dans l’IT. C’est Lavanya Sankaran, auteur, qui nous l’expliquait, en juillet dernier, alors que nous étions sur place : Bangalore est la capitale indienne du suicide. Un triste record qui se mesure à hauteur de 35 suicides pour 100 000 personnes, selon le bureau national indien d’enregistrement des crimes – le suicide est illégal en Inde ; une tentative avortée peut conduire en prison. En février dernier, des médecins confiaient à notre confrère Vicky Nanjappa recevoir au moins 10 patients par jour pour le stress. Celui-ci trouverait notamment sa source dans les difficultés de déplacement liées aux embouteillages, mais aussi à l’absence de vie sociale pour les jeunes indiens travaillant pour l’industrie IT locale et, aussi, le besoin constant, pour les salariés des entreprises de BPO, de jongler entre cultures.
Des syndicats inexistants
C’est justement à Bangalore que nous avons rencontré Karthik Shekkar, secrétaire général pour l’Inde du syndicat Unites Professionnal, très mal représenté dans les entreprises. Interrogées sur le sujet de la représentation syndicale, aucune des SSII rencontrées en Inde n’a reconnu le moindre syndicat face à nous.
Les syndicats, selon Infosys et KPIT
Unites Professionnal, qui se veut dédié à l’industrie IT, est jeune : il est né en septembre 2005 et revendique plus de 15 000 adhérents. Mais son histoire est déjà tourmentée. Karthik Shekkar raconte ainsi avoir des « sympathisants », qui n’osent pas adhérer sous la pression de leur employeur. Il explique avoir dû « s’expliquer » avec des représentants de Wipro pour défendre jusqu’au droit à exister de son syndicat : « Wipro est très fortement opposé aux syndicats. » Même constat pour Infosys, notamment. Mais, chez TCS, « nous n’avons pas rencontré beaucoup de succès car, en premier lieu, les salariés sont très bien traités. »
Une subtilité législative locale « bride » le syndicat dans son développement : les cadres peuvent adhérer à une association, pas à un syndicat. Mais elle n’explique pas tout : « mes adhérents chez HSBC ont été menacés ; ils ont quitté le syndicat. » Chez Axa, « on nous a expliqué que discuter avec les syndicats était une perte de temps. »
Des conditions contractuelles discutables
Mais Karthik Shekkar s’élève surtout contre les clauses de « fidélité » que certaines SSII font signer, en Inde, à leurs recrues, et notamment celles qu’elles détachent, sur site, à l’étranger. Ces clauses, en avenant au contrat initial, sont globalement simples : l’employé s’y engage à revenir en Inde à l’issue de sa mission et à rester un certain temps dans l’entreprise. Faute de quoi il devra la dédommager financièrement : « initialement, tout allait bien. Ces addenda au contrat de base ne concernaient que l’employeur et l’employé. Mais maintenant ces avenants doivent être garantis par les parents. » Pour Karthik Shekkar, « c’est un sujet de contentieux. […] Nous luttons contre ce genre de situations chez Infosys ».
Extraits des actions conduites par le syndicat indien Unites
Le syndicaliste s’élève aussi contre le non paiement des heures supplémentaires, un sujet qui ne semblait pas trop préoccuper l’un de ces salariés que nous avons pu interroger : « le salarié dispose-t-il vraiment, sur son temps de travail officiel, du temps nécessaire pour accomplir sa mission ? C’est une question très inconfortable. » Pour Karthik Shekkar, « les salariés travaillent en réalité inévitablement deux à trois heures de plus que les 8 heures quotidiennes officielles, du temps pour lequel ils ne sont pas payés. »
Une lutte balbutiante contre le harcèlement sexuel
Pour Karthik Shekkar, « il y a aussi beaucoup de harcèlement sexuel, des faveurs demandées par des supérieurs ; des cas sur lesquels les entreprises préfèrent rester aveugles ». Quitte à inciter les victimes à la démission. Et pourtant, selon la législation, « chaque entreprise doit disposer d’une cellule interne de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement sexuel. Mais aucune ne prend le sujet au sérieux. »
Comme nous l’expliquait Lavanya Sankaran en juillet dernier, la sexualité reste un sujet sensible en Inde. Mais le problème a dû prendre suffisamment d’ampleur, et les mentalités de maturité, pour que le Nascomm décide, mi-octobre, de lancer une première campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans les entreprises IT.
L’IT continue d’attirer
Quoiqu’il en soit, l’industrie IT continue d’être un débouché très attractif pour les étudiants indiens – quand bien même les jeunes salariés de cette industrie deviendraient de moins bons partis du fait de la crise économique mondiale. Partho Ganguli avance une explication : « c’est quelque chose de construit depuis l’enfance ». Lavanya Sankaran complète : « après toutes ces générations qui ont porté au pinacle les mathématiques et la science ; voilà que le monde a enfin besoin de nos compétences. Nous sommes prêts ! » Le succès de l’industrie IT indienne, c’est comme une grande fête nationale qui dure depuis des années.
La technologie ? C'est dans l'ADN de l'Inde
Plus prosaïquement, l’attraction se construit aussi sur la base de promesses de meilleure voiture, meilleure maison, voire d’expatriation, le gros lot de la loterie de l’embauche. A tel point que, chez Logica, à Bangalore, on revendique quatre à cinq mille candidats pour une opération portes ouvertes de quatre heures.